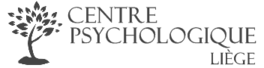Depuis plusieurs années, les professionnels de santé mentale observent une augmentation préoccupante des diagnostics psychologiques et psychiatriques, notamment chez les enfants et adolescents. Parmi les plus fréquents : le TDAH, les troubles anxieux, le haut potentiel, les troubles du spectre autistique (TSA).
Si cette reconnaissance accrue peut être salutaire, elle pose une question essentielle : sommes-nous en train de trop diagnostiquer ?
Une société qui étiquette à toute vitesse
Dès les premières difficultés scolaires ou comportementales, les familles sont de plus en plus orientées vers un avis spécialisé. Agitation, rêverie, hypersensibilité, opposition, ennui en classe… Ces signes, parfois transitoires, sont aujourd’hui rapidement associés à un trouble, souvent sans évaluation approfondie.
Résultat : des enfants reçoivent un diagnostic de TDAH, HPI, TSA ou trouble anxieux généralisé sur la base d’un seul bilan ou d’un simple questionnaire. Dans bien des cas, les professionnels eux-mêmes reconnaissent que le contexte est insuffisamment pris en compte : fatigue, séparation parentale, déménagement, pression scolaire…
Pourquoi cette vague de surdiagnostics ?
Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène :
- Une meilleure visibilité des troubles psychiques (campagnes de sensibilisation, réseaux sociaux, médias);
- Une attente de réponse rapide de la part des parents ou des enseignants;
- Une pression sur les professionnels pour poser un diagnostic clair;
- Un besoin de « traduire » la souffrance en étiquette médicale, parfois pour obtenir des aides ou des aménagements scolaires.
Mais cette logique, bien que compréhensible, comporte un risque : réduire la complexité psychique à une simple case.
Le prix d’un diagnostic mal posé
Un diagnostic non fondé ou trop rapide peut avoir des effets contre-productifs :
- L’enfant ou l’adulte s’identifie à une étiquette qui ne correspond pas à sa réalité;
- Les traitements ou accompagnements proposés ne sont pas adaptés;
- Le risque de stigmatisation augmente, notamment à l’école ou au travail;
- D’autres causes (émotionnelles, sociales, familiales) sont négligées.
À terme, ce phénomène contribue à dégrader la confiance dans le champ psychologique, et à banaliser des diagnostics qui méritent au contraire d’être posés avec sérieux.
Diagnostiquer, oui — mais pas à tout prix
Il ne s’agit pas de nier l’existence des troubles psychiques, ni de refuser l’accès au soin. Bien au contraire. Mais diagnostiquer ne devrait jamais être un réflexe rapide, ni une réponse automatique à une difficulté passagère.
Un véritable diagnostic clinique s’appuie sur :
- Une observation sur le temps long;
- Des entretiens croisés avec l’individu, son entourage, ses enseignants (pour les enfants);
- Des bilan(s) psychométriques ou neuropsychologiques si nécessaire;
- Une mise en contexte globale : histoire de vie, environnement, dynamique familiale.
Remettre du discernement au cœur de la clinique
Cette vague de surdiagnostics est un signal d’alerte : il nous faut revenir à une clinique plus fine, plus humaine, plus individualisée.
Le rôle du psychologue n’est pas seulement de nommer un trouble, mais de comprendre la personne dans sa globalité, dans ce qu’elle vit, ce qu’elle traverse, ce qu’elle exprime — parfois à travers un symptôme.
Un diagnostic bien posé peut ouvrir des portes. Un diagnostic mal posé peut en refermer bien plus.